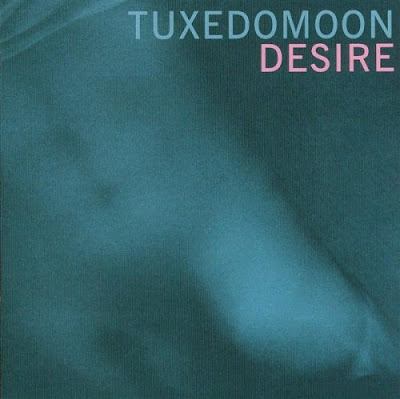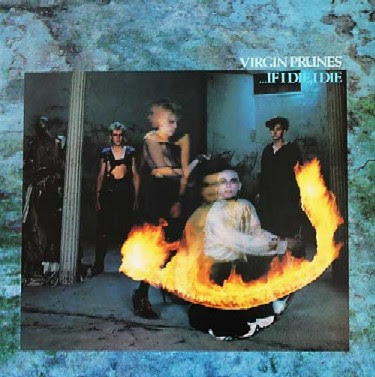Auréolée d’une réputation de fille douée et en colère, PJ Harvey n’est peut-être pas celle que l’on croit. A trop crier partout "Je t’aime pas mais l’autre là-bas, ne la regarde pas sinon je te fais manger un œil", les hommes ont fini par devenir ses ennemis numéro 1.
Article paru le 7 juillet 2009 sur Inside Rock
Sur la pochette de A Woman A Man Walked By (Island Records, 2009) et sur les photos-promo, John Parish et PJ Harvey affichent la complicité d’un couple de meilleurs amis : on se tape dans le dos, on se file des plans pour jouer un accord de guitare, on se moque de l’autre lorsqu’il bafouille dans le micro et on ne se regarde même pas lorsqu’on joue à la télé car on se fait confiance.
Naturellement, cette belle amitié entre la chanteuse et le professeur d’arts est émouvante, mais un vrai amoureux se cache-t-il derrière les couplets d’amour (et de colère) que Polly Jean Harvey compose à l’ombre des amandiers du Dorset ? Cet amoureux invisible, ce n’est pas John Parish, âme sœur de PJ, reflet d’initiales, qui lui apprend à jouer de la guitare et la suit, depuis Automatic Dlamini, le premier groupe de Parish, dans lequel elle joua notamment du saxophone. Non. En réalité, on ne sait rien, ou presque, des battements du cœur de cette fille à la grande bouche peinturlurée de chair de baleine... Mais peut-être qu’en compilant correctement, des noms surgiront : Steve Albini, Nick Cave, et même Vincent Gallo. C’est du lourd, et c’est même du très beau garçon, mais cela n’explique pas leur statut temporaire dans la vie de celle qui postillonne "I’m sucking ’till I’m white/You leave me dry"… sur le single Dry, en 1993 (Island Records). Interrogeons-nous : Pourquoi ? Pourquoi PJ Harvey semble être toujours une célibataire en colère ?
Steve
Albini : connu pour travailler uniquement en analogique et pour le
tarif unique appliqué à tout groupe toquant à la porte de son studio à Chicago
(600€ la journée), Steve Albini est le fondateur de Shellac et le producteur de
tout ce que la terre porte de noise et de punk et d’indie. Cela tombe bien, PJ
Harvey vient tout juste de dépenser ses petites économies dans la location de
son premier appartement à Londres. Par ailleurs, Island Records, son nouveau
label, aime sa protégée hargneuse mais ne souhaite pas dépenser trop
d’argent : deux semaines et pas un jour de plus devront suffire à
l’enregistrement de Rid Of Me (Island Records, 1993), prometteuse
collaboration du producteur sans concession et de l’artiste. S’alimentant
uniquement de pommes de terres et de sauces assorties durant ces deux
semaines (C’est Steve qui le dit lui même),
PJ Harvey défie son micro comme on défie un homme qui se refuse et Steve Albini
capte, silencieux et encourageant, la défiance de cette fille de 23 ans. En
confiance, Polly Jean fait vibrer sa gorge, se brise les abdominaux, racle,
éructe, grogne, murmure tandis qu’Albini imprime sur ses bandes magnétiques la
pudeur violente de cette fille qui semble vouloir tout faire toute seule...
Mais deux semaines ne suffisent pas à deux cœurs qui pourraient battre de
concert. PJ Harvey quitte le studio à reculons, vidée. Tout est dit dans Rid
Of Me et Albini ne touchera plus aux cordes sensibles de Polly.
Ce
qu’elle aurait dû faire : Manger autre chose que des pommes de terre.
Pour séduire un homme, il existe des mets plus encourageants.
Nick Cave : Nick Cave... Ah, Nick
Cave... PJ Harvey est fan de la bande de l’australien et lorsque celui-ci la
contacte pour l’accompagner sur le duo Henry Lee (sur Murder Ballads,
Mute, 1995), elle pense à toutes ses copines de lycée qui sont devenues femmes
au foyer et qui repassent les bermudas de leur mari. Depuis Rid Of Me,
PJ Harvey est devenue une rockeuse internationale, ses succès se sont enchainés
avec classe et n’ont laissé guère l’occasion à l’amour de s’immiscer dans sa
culotte (dont elle se coiffera dans le clip de The Letter en 2004). Le
monde de l’indie attend cette rencontre et elle a lieu : la vidéo de Henry
Lee se termine sur un french kiss à l’attention de ceux qui doutaient
encore que ces deux-là étaient faits pour se rentrer dedans, artistiquement,
personnellement, sentimentalement. Les deux vivent une passion irréelle pour
leurs fans respectifs mais lassée ou juste enquiquinante, PJ Harvey décide de
rompre et de plonger par la même occasion Nick Cave dans un chagrin profond,
comme si ce Nosferatu du Rock n’était pas déjà un type suffisamment sombre.
Elle quitte leur appartement de Londres, récupère ses robes de Dame Cave et
file, ailleurs. Nick Cave compose dans la foulée Boatman’s Call, hommage
à sa belle voleuse, à ses yeux verts (Green Eyes) et ses cheveux noirs (Black
Hair). Culpabilisant, repensant à ses copines de lycée, craignant de
rejoindre leur club de lecture, elle dédicace son album suivant Is This
Desire ? (Island Records, 1998) à Nick. Quatre petites lettres noires
sur fond blanc pour souligner la culpabilité et l’amour inconstant dont elle
semble s’excuser.
Ce
qu’elle n’aurait jamais dû faire : sortir avec son idole.
Vincent
Gallo : Remballant son chagrin et le sentiment d’avoir échoué avec son
âme sœur australienne, PJ Harvey s’envole pour New-York, États-Unis, pour
respirer un autre air et loucher sur ce drôle de garçon qu’est Vincent
Gallo : le beau Vincent Gallo fait chavirer des navires entiers de filles
par un simple mot qui sort de sa bouche. Elle tombe dans le piège, l’étau se
referme sur celle qui a souffert d’un physique qu’elle estimait disgracieux
depuis son adolescence. Parce qu’il la regarde, l’aime peut-être un peu et
parce qu’il l’emmène dans des quartiers exotiques de NYC, Polly chavire à son
tour et compose l’album Stories From The City, Stories From The Sea
(Island Records, 2000), dans lequel elle répond à la question posée par l’album
précédent : Is This Desire ?. Pire que ça : This Is
Love, dit-elle. Le ton de l’album est triomphant, surproduit, et elle
apparaît plus que jamais sûre d’elle. Cela est évidemment étrange provenant de
cette solitaire qui avait eu peur de quitter sa campagne natale pour Londres.
La voici à New-York, amoureuse d’un lascard. L’album ne fera pas date... Cette
romance éclate au grand jour lors de la sortie de l’abum Uh Huh Her
(Island Records, 2004). Il s’ouvre sur le titre The Life and Death of
Mr. Badmouth, adressé à la langue de vipère notoire qu’est Vincent
Gallo. Les autres titres de l’album soulignent l’affirmation de PJ Harvey.
Parce que c’est nécessaire de s’assurer qui l’on est après avoir été écartée
par un méchant garçon. N’est pas Chloë Sevigny qui veut.
Ce
qu’elle aurait dû faire : le planter au milieu de Central Park et
rentrer à Londres pour Nick ou à Perpignan, pour Pascal (Comelade).
Lassée
une nouvelle fois, PJ Harvey évite la dépression en composant un album dans un
pur style victorien et écrit à la craie blanche une sensibilité ténue, fragile,
sur des pistes lumineuses et cristallines (White Chalk, [Island Records,
2007]). John Parish, l’ami de toujours accourt, peu après, pour lui donner son
épaule. Elle s’épanche. Elle écrit Black Hearted Love et les hommes
recommencent à tomber amoureux d’elle.
Article paru le 7 juillet 2009 sur Inside Rock